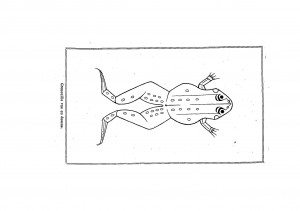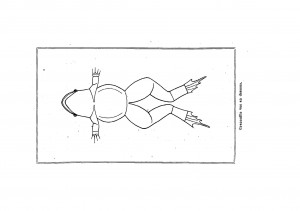Le rane, la lingua e dio
MICHEL FOUCAULT LETTORE DI JEAN PIERRE BRISSET, “PRINCE DES PENSEURS”
di Enrico Valtellina
Esce questo mese (giugno 2010) su Diogene http://www.diogenemagazine.eu/ questo mio articoletto su Brisset.
Il Principe dei pensatori non viveva del suo pensiero. Come i più grandi, Baruch Spinoza molava lenti, Jakob Böhme era ciabattino. Jean Pierre Brisset (1837-1919) è stato apprendista pasticcere, militare, istruttore di nuoto, insegnante di lingue vive, commissario alla sorveglianza amministrativa delle ferrovie. Mentore del surrealismo, capitoletto nell’Antologia dell’Humor nero di Breton, evento patafisico, strabiliante cesellatore di etimologie fantastiche, serissimo scrutatore dell’origine della lingua, teologo batraciano, Brisset non godette in vita di alcuna gloria. Al pensiero non serve una cattedra per fluire, l’eccedenza trova le sue strade, così l’omino anziano, goffo e pelato che il circolo di Jules Romains aveva eletto Prince des Penseurs per scherno gioioso, fotografandolo sotto Il pensatore di Rodin, è ancora lì, segno enigmatico come la lingua su cui si è accanito per una vita. Quale? Ma il francese, la lingua delle rane.
Procediamo con ordine nella ricognizione dell’opera di Brisset. Il suo esordio saggistico è ad un tempo eccentrico e programmatico, si tratta di La natation ou l’art de nager appris seul en moins d’une heure (avec cinq figures) del 1871, manuale per l’autoapprendimento veloce del nuoto a rana. Già appaiono alcuni temi che saranno la portante delle ricerche linguistiche, antropologiche e teologiche successive, l’uomo, l’acqua, le rane. Alcuni esegeti hanno visto in quest’opera, in relazione alla produzione successiva, qualcosa di prossimo a una “raccolta di esercizi spirituali nella tradizione di Ignazio di Loyola o di Francesco di Sales”. Brisset era anche inventore, e l’umanità deve al suo genio l’ideazione, brevetto n°119713 del 28 novembre 1876, di una cintura per natazione.
L’interesse centrale al complesso del suo sistema non tarda comunque a palesarsi, inizialmente ancora in forma di manuale. Brisset conosceva l’italiano: dopo esser stato ferito nella battaglia di Magenta, venne ricoverato per un periodo a Pavia, conosceva il tedesco: essendo stato ferito alla testa nella battaglia di Sedan e deportato a Magdeburgo. Fallito il tentativo di vivere insegnando nuoto a Marsiglia, tornò a Magdeburgo per insegnarvi il francese. Mancando un testo adeguato alle sue metodologie, lo scrisse, il Methode zur Erlernung der Französischen Sprache.
Ormai votato alla lingua, insoddisfatto del vaniloquio accademico sull’oggetto del suo studio, pubblica nel 1878 la Grammaire logique. Primo testo teorico di Brisset, il sottotitolo è “o teoria di una nuova analisi matematica, che risolve le questioni più difficili e che tratta approfonditamente:
1° del participio passato
2° del participio presente
3° della collocazione dei pronomi dopo l’imperativo;
in tutto tre regole logiche, le sole vere e senza alcuna eccezione, riassunte in dodici parole”. L’analisi grammaticale logicamente condotta manifesta progressivamente i propri potenziali, per cui Brisset intraprende una revisione della sua opera, apparsa nel 1884, il titolo è il medesimo, La grammaire logique, il sottotitolo più ambizioso: “che risolve tutte le difficoltà e che fa conoscere attraverso l’analisi della parola la formazione delle lingue e quella del genere umano, di Pierre Brisset, Professore anziano di lingue viventi”, così il motto sul frontespizio: La Parole est Dieu.
Nella seconda edizione è inscritta un’accelerazione del discorso. La revisione procede per approfondimento del tema originario fino al giorno di giugno del 1883 in cui, dall’interno di sé, Gesù gli parlò.
Gli ultimi capitoli del libro si aprono conseguentemente su problematiche che si scostano dalle progettualità grammaticali originarie.
In particolare Brisset analizza le lingue vive e morte, del latino dice essere un argot, una lingua inventata come il volapük, un imbastardimento della lingua originaria, così come l’ebraico, il sanscrito e il greco. Anche il metodo di indagine della lingua appare nella sua prima formulazione, quantunque ancora immatura: tutte le sillabe conservano la memoria di un significato originario, l’analisi comparata dei termini assonanti rivela la verità del termine in oggetto.
Tracciato il solco dell’analisi linguistica, la seconda edizione della Grammatica logica getta le basi di una storia dell’umanità.
Nel 1859 era apparso L’origine delle specie di Darwin, Brisset coglie l’importanza dell’intuizione della dinamica evolutiva, ma ritiene necessario un superamento del darwinismo: «Riconosciamo volentieri l’immenso servigio reso da Darwin alla scienza e, anche se non lo abbiamo letto, ne abbiamo subito fortemente l’influenza, coltivata in conversazioni con amici suoi sostenitori e nella lettura di articoli di giornale » (Brisset 2001, p.472), così come un’interpretazione adeguata del testo biblico, per giungere a una formulazione dell’origine dell’uomo compiutamente logica, nonché capace di evitare il pensiero ripugnante che i suoi antenati fossero irsuti, brutali, privi di voce e compiutamente bestiali. Gli uomini hanno subìto la medesima evoluzione delle rane, e i primi suoni che riuscirono ad emettere non erano privi di ragione, e si sono conservati intatti nel loro valore semantico fino alle lingue moderne. L’evoluzione è stata lenta e, ad esempio nel mito di Venere che sorge dalle acque (o meglio dagli stagni o dai pantani, rimarca Brisset), si trova memoria di questa origine comune alle rane. La seconda edizione della Grammatica logica inaugura il sistema filosofico brissettiano, individua il metodo e i temi sviluppati nelle opere successive. Progressivamente il discorso antropologico-linguistico, forse conseguentemente, vira verso l’orizzonte escatologico, le opere successive tracceranno ciò che Raymond Queneau ha chiamato la “teologia generativa” di Jean Paul Brisset.
I frontespizi dei libri di Brisset sono sempre esplicativi rispetto ai contenuti, ecco quello del suo primo libro compiutamente “teologico”: Pierre Brisset, libro santo e sacro riservato ai puri e agli eletti: Il mistero di Dio è compiuto, e come motto “Dio è scienza. Suona, settima tromba! (apocalisse, VI, 15)”. Uno dei primi temi affrontati è l’opzione monoteismo vs. politeismo.
Se è vero che l’uomo è figlio di dio , gli uomini son figli degli dei.
«La creazione di Dio non è l’uomo animale, ma l’uomo spirituale che vive per la potenza della Parola, e la parola prende origine dai nostri più remote antenati, le rane, più di un milione e meno di dieci milioni di anni fa» (Brisset, 2001, p. 506).
La rana non ha sesso apparente, ma progressivamente, nell’evoluzione, si è sessuata e, con l’apparizione del desiderio sessuale, si sono prodotte le parole adeguate ad esprimerlo. L’economia del presente testo ci impedisce di entrare nei dettagli della cosmologia evolutiva brissettiana, invitiamo i lettori a confrontarsi personalmente col pensiero di Brisset per coglierne la straordinaria articolazione, tre suoi testi principali sono disponibili sul sito www.gallica.bnf.fr. Mi limiterò a indicare alcuni temi ricorrenti, come la sovrapposizione tra il papa di Roma e l’anticristo, che sarà sviluppato principalmente ne Le profezie compiute (Daniele e l’Apocalisse) del 1906.
La cosa più strabiliante di Brisset, è comunque il metodo di analisi linguistica, ormai compiutamente definito nei testi della maturità: i suoni originari conservano una matrice di senso che si manifesta nel confronto con termini assonanti. La parte più cospicua dei suoi testi è sostanziata da raccordi omofonici tra termini, l’assonanza fa da ponte tra le parole, individuando percorsi di senso che corroborano gli assunti ontologici ed epistemologici brissettiani. Logica del calembour, legittimata da Gesù, allorché vi ricorse nell’individuare il suo successore: «Tu sei Pietro, e su questa pietra…».
Ecco un esempio del lavoro di Brisset sulla genesi di immaginazione e origine, in originale, essendo ribadita dall’autore l’intraducibilità della sua opera:
«Eau rit, ore ist, oris. J’is nœud, gine. Oris = gine = la gine urine, l’eau rit gine. Au rige ist nœud. Origine. L’écoulement de l’eau est à l’origine de la parole. L’inversion de oris est rio, et rio ou rit eau, c’est le ruisseau. Quant au mot gine il s’applique bientôt à la femelle: tu te limes à gine? Tu te l’imagines. Je me lime, à gine est? Je me l’imaginais. On ce, l’image ist né; on ce, lime a gine ai, on se l’imaginait. Lime a gine à sillon; l’image ist, nœud à sillon; l’image ist, n’ai à sillon».
Non serve conoscere il francese per comprendere la metodica dell’analisi linguistica brissettiana.Le ultime opere, La science de Dieu ou la création de l’homme e Les origines humaines portano a compimento l’edificio teorico brissettiano, sempre più presente è il riferimento all’Apocalisse giovannea, come naturale per chi si qualificava come “Arcangelo della resurrezione e il settimo angelo dell’Apocalisse”.
Michel Foucault ha dedicato due brevi testi a Brisset, Le cycle des grenouilles, apparso nel 1962 su La nouvelle revue française, e Sept propos sur le septième ange, scritto come introduzione alla riedizione della Science de Dieu[1]. Non stupisce scoprire in Michel Foucault l’interesse per un divergente come Brisset, sapendo che all’opera di un altro scrittore limite come Raymond Roussel ha dedicato un libro, e che si era entusiasmato scoprendo i procedimenti linguistici deliranti di Louis Wolfson[2].
Foucault analizza la specificità della ricerca brissettiana sull’origine delle lingue. Nella sua storia, Duret, de Brosses, Court de Gébelin, la ricerca di una matrice originaria ad ogni lingua si muoveva verso un orizzonte comune, una mitica lingua arcaica da cui i differenti idiomi si sarebbero differenziati. In Brisset all’origine è il francese che ritorna su se stesso «come se fosse stato parlato nei tempi più remoti, con le stesse parole, a cui è accaduto poco, solo sono distribuite in un ordine differente, ribaltate da delle metastasi, accatastate o distribuite da delle dilatazioni e delle contrazioni (Foucault, 1986, p.12-13)». Lo stato primitivo della lingua è per lui «uno stato fluido, mobile, indefinitamente penetrabile del linguaggio, una possibilità di circolarvi in ogni senso, il campo libero ad ogni trasformazione, rovesciamento, ritaglio, la moltiplicazione in ogni punto, in ogni sillaba o sonorità, dei poteri della designazione (Foucault, 1986, p.14)». Ripetizione del caso della lingua, turbine semantico, organizzato. Cercare l’origine è per Brisset, a differenza che per gli altri linguisti citati, disporre la proliferazione degli enunciati, «rivolgere l’organizzazione del sistema verso l’esteriorità delle cose dette (Foucault, 1986, p.25)». Il procedimento brissettiano, la Scienza di Dio, organizza il magma delle cose dette attraverso una forma specifica di approssimazione, salta, batracianamente, da un termine all’altro guidato dall’assonanza, materializzando scene di desiderio, di guerra, di devastazione, o i gorgheggi dei demoni e delle rane.
In psichiatria, il gioco sul linguaggio che si fa condurre dal procedere sonoro piuttosto che dal senso ha un nome, «fuga delle idee», Foucault ritiene tale categorizzazione inadeguata a Brisset in cui, al contrario «la ripetizione fonetica non marca […] la liberazione totale del linguaggio in rapporto alle cose, ai pensieri e ai corpi, […ma] sforza le sillabe nei corpi, rendendo loro funzione di grida e di gesti, ritrova il grande potere plastico che vocifera e gesticola, ficca le parole nella bocca e intorno al sesso, fa nascere e manifestarsi in un tempo più rapido d’ogni pensiero un turbine di scene frenetiche, selvagge o giubilatorie, da cui le parole sorgono e che le parole nominano. Sono l’Evohé multiplo di questi baccanali. Piuttosto che una fuga delle idee a partire da un’interazione verbale, si tratta di una scenografia fonetica indefinitamente accelerata (Foucault, 1986, p.42-43)».
I testi di Foucault su Brisset lasciano trasparire la fascinazione per un’opera limite, tanto rigorosa quanto divergente, malìa di cui sono stato a mia volta vittima quando ho scoperto il Principe dei pensatori. Visto che ci è impossibile culturalmente avvalorare l’opera di Brisset come costrutto scientifico, amiamola come favola, della rana che si trasforma in Principe. Si consiglia, prima della sua lettura, di leccare un rospo.
Bibliografia
Jean Pierre Brisset, Ouvres completes, Paris, Les presses du réel, c2001
Jean Pierre Brisset, su www.gallica.bnf.fr
André Breton, Antologia dello humor nero, Torino, Einaudi, 1970.
Michel Foucault, «Le cycle des grenouilles», La Nouvelle Revue française, 10e année, no 114, juin 1962, pp. 1159-1160. (Sur J.-P. Brisset, La Science de Dieu ou la Création, Paris, Charmuel, 1900.)
Michel Foucault, Sept propos sur le septième ange, Paris, Fata Morgana, 1986.
Ecco i testi di Foucault su Brisset in originale:
«Le cycle des grenouilles», La Nouvelle Revue française, 10e année, no 114, juin 1962, pp. 1159-1160. (Sur J.-P. Brisset, La Science de Dieu ou la Création, Paris, Charmuel, 1900.)
Pierre (ou Jean-Pierre) Brisset, ancien officier, donnait des leçons de langues vivantes. Il dictait. Ceci, par exemple: «Nous, Paul Parfait, gendarme à pied, ayant été envoyé au village Capeur, nous nous y sommes rendu, revêtu de nos insignes. Nous y avons été reçu et acclamé par une population affolée, que notre présence a suffi à rassurer.» C’est que les participes le préoccupaient. Ce souci le mena plus loin que bien des professeurs de grammaire: à réduire, en 1883, le latin «à l’état d’argot», à rentrer chez lui, pensif, un jour de juin de cette même année 1883 et à concevoir le mystère de Dieu, à redevenir comme un enfant, pour comprendre la science de la parole, à se faire lui-même l’éditeur d’une oeuvre dont l’Apocalypse pourtant avait annoncé l’imminence, à donner, en la Salle des Sociétés savantes, une conférence dont Le Petit Parisien fit mention en avril 1904. Polybiblion ** parle de lui sans faveur: il serait un
* Char (R.), «Seuil», in Fureur et Mystère (1948), in Oeuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1983, p. 255.
** Polybiblion: Revue universelle bibliographique (mensuel publié par la Société bibliographique).
|PAGE 204
suppôt du combisme et de l’anticléricalisme borné. J’espère montrer un jour qu’il n’en est rien.
Brisset appartient -appartenait, je suppose qu’il est mort -à une autre famille: cette famille d’ombres qui a recueilli ce que la linguistique, dans sa formation, laissait en déshérence. Dénoncée, la pacotille des spéculations sur le langage devenait entre ces mains pieuses, avides, un trésor de la parole littéraire: on cherchait avec une obstination remarquable, quand tout proclamait l’échec, l’enracinement du signifié dans la nature du signifiant, la réduction du synchronique à un état premier de l’histoire, le secret hiéroglyphique de la lettre (à l’époque des égyptologues), l’origine pathétique et coassante des phonèmes (descendance de Darwin), le symbolisme hermétique des signes: le mythe immense d’une parole originairement vraie.
Révéroni Saint-Cyr, avec le rêve prémonitoire d’une algèbre logique, Court de Gebelin et Fabre d’Olivet, avec une érudition hébraïque certaine, avaient chargé leurs spéculations de toute une gravité démonstrative *. À l’autre extrémité du siècle, Roussel n’use que de l’arbitraire, mais d’un arbitraire combiné: un fait de langage (l’identité de deux séries phonétiques) ne lui révèle aucun secret perdu dans les paroles; il lui sert à cacher un procédé créateur de paroles et suscite tout un univers d’artifices, de machineries concertées dont l’apparente raison est donnée, mais dont la vérité reste enfouie (indiquée mais pas découverte) dans Comment j’ai écrit certains de mes livres **.
Brisset, lui, est juché en un point extrême du délire linguistique, là où l’arbitraire est reçu comme l’allègre et infranchissable loi du monde; chaque mot est analysé en éléments phonétiques dont chacun vaut lui-même pour un mot; celui-ci à son tour n’est qu’une phrase contractée; de mot en mot, les ondes du discours s’étalent jusqu’au marécage premier, jusqu’aux grands éléments simples du langage et du monde: l’eau, la mer, la mère, le sexe. Cette phonétique patiente traverse le temps en une fulguration, nous remet en présence des batraciens ancestraux, puis dévale la cosmogonie, la théologie et le temps à la vitesse incalculable des mots qui jouent
* Révéroni Saint-Cyr (baron J.-A. de), Essai sur le perfectionnement des beaux-arts par les sciences exactes, ou Calculs et Hypothèses sur la poésie, la peinture et la musique, Paris, C. Pougens, 1803, 2 vol. Court de Gebelin (A.), Histoire naturelle de la parole, ou Origine du langage, de l’écriture et de la grammaire universelle, Paris, De Valleyre, 1772. Fabre d’Olivet (A.), La Langue hébraïque restituée et le Véritable Sens des mots hébreux rétabli et prouvé par leur analyse radicale, Paris, chez l’auteur, 1815.
** Roussel (R.), Comment j’ai écrit certains de mes livres, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1963.
|PAGE 205
sur eux-mêmes. Tout ce qui est oubli, mort, lutte avec les diables, déchéance des hommes n’est qu’un épisode dans la guerre pour les mots que les dieux et les grenouilles se livrèrent jadis au milieu des roseaux bruyants du matin. Depuis, il n’est rien, il n’est pas de chose bornée et sans bouche qui ne soit mot muet. Bien avant que l’homme fût, ça n’a pas cessé de parler.
Mais, comme le rappelle notre auteur, «tout ce qui précède n’est pas encore suffisant pour faire parler ceux qui n’ont rien à dire».
Sept propos sur le septième ange
«Sept propos sur le septième ange», in Brisset (J.-P), La Grammaire logique, Paris, Tchou, 1970, pp. 9-57.
1
La Science de Dieu et, pour une bonne part, La Grammaire logique se donnent comme une recherche sur l’origine des langues. Recherche traditionnelle pendant des siècles, mais qui, depuis le XIXe siècle, a été dérivée peu à peu du côté du délire. Soit une date symbolique pour cette exclusion: le jour où les savantes sociétés ont refusé les mémoires consacrés à la langue primitive.
Mais, dans cette longue dynastie, un beau jour exilée, Brisset occupe une place singulière, et joue les perturbateurs. Tourbillon soudain, parmi tant de délires doux,
|PAGE 14
II. LE PRINCIPE DE NON-TRADUCTION
Il est dit dans l’ Avertissement de La Science de Dieu: «Le présent ouvrage ne peut être entièrement traduit.» Pourquoi? L’affirmation ne manque pas d’étonner, venant de qui recherche l’origine commune à toutes les langues, Cette origine n’est-elle pas constituée, comme le veut une tradition singulièrement illustrée par Court de Gébelin, d’un petit nombre d’éléments simples liés aux choses mêmes et demeurés sous forme de traces dans toutes les langues du monde? Ne peut-on -directement ou non -ramener à elle tous les éléments d’une langue? N’est-elle pas ce en quoi n’importe quel idiome peut être retraduit et ne forme-t-elle pas un ensemble de points par lesquels toutes les langues du monde actuel ou passé communiquent? Elle est l’élément de l’universelle traduction : autre par rapport à toutes les langues et la même en chacune d’elles.
Or ce n’est point vers cette langue suprême, élémentaire, immédiatement expressive que se dirige Brisset. Il reste sur place, avec et dans la langue française, comme si elle était à elle-même sa propre origine, comme si elle avait été parlée du fond des temps, avec les mêmes mots, ou peu s’en faut, distribués seulement dans un ordre différent, bouleversés par des métathèses, ramassés ou distendus par des dilatations et des contractions. L’origine du français, ce n’est point pour Brisset ce qui est antérieur au français; c’est le français jouant sur lui-même, et tombant là, à l’extérieur de soi, dans une poussière ultime qui est son commencement.
Soit la naissance du pouce: «Ce pouce = ce ou ceci pousse. Ce rapport nous dit que l’on vit le pouce pousser, quand les doigts et les orteils étaient déjà nommés. Pous ce = prends cela. On commence à prendre les jeunes pousses des herbes et des bourgeons quand le pouce, alors jeune, se forma. Avec la venue du pouce, l’ancêtre devint herbivore.» À vrai dire, il n’y a pas pour Brisset une langue primitive qu’on pourrait mettre en correspondance avec les divers éléments des langues actuelles, ni même une certaine forme archaïque de langue dont on pourrait faire dériver, point par point, celle que nous parlons; la primitivité est plutôt pour lui un état fluide, mobile, indéfiniment pénétrable du langage, une possibilité d’y circuler en tous sens, le champ libre à toutes les transformations, renversements, découpages, la multiplication en chaque point, en chaque syllabe ou sonorité, des pouvoirs de désignation. À l’origine, ce que Brisset découvre, ce n’est pas un ensemble limité de mots simples fortement attachés à leur référence, mais la langue telle que nous la parlons aujourd’hui, cette langue elle-même à
|PAGE 15
l’état de jeu, au moment où les dés sont jetés, où les sons roulent encore, laissant voir leurs faces successives. En ce premier âge, les mots bondissent hors du cornet décisif, et sans cesse sont repris par lui, retombant à nouveau, chaque fois selon de nouvelles formes et suivant des règles différentes de décomposition et de regroupement: «Le démon = le doigt mien. Le démon montre son dé, son dais, ou son dieu, son sexe… La construction inverse du mot démon donne: le mon dé = le mien dieu. Le monde ai = je possède le monde. Le démon devient ainsi le maître du monde en vertu de sa perfection sexuelle… Dans son sermon, il appelait son serf: le serf mon. Le sermon est un serviteur du démon. Viens dans le lit mon: le limon était son lit, son séjour habituel. C’était un fort sauteur et le premier des saumons. Voir le beau saut mon.» Dans le langage en émulsion, les mots sautent au hasard, comme dans les marécages primitifs nos grenouilles d’ancêtres bondissaient selon les lois d’un sort aléatoire. Au commencement étaient les dés. La redécouverte des langues primitives n’est point le résultat d’une traduction; c’est le parcours et la répétition du hasard de la langue.
C’est pourquoi Brisset était si fier d’avoir démontré que le latin n’existait pas. Si latin il y avait eu, il faudrait bien remonter du français actuel vers cette autre langue différente de lui et dont il serait dérivé selon des schémas déterminés; et, au-delà, il faudrait encore remonter vers l’état stable d’une langue élémentaire. Supprimé le latin, le calendrier chronologique disparaît; le primitif cesse d’être l’antérieur; il surgit comme les chances, soudain toutes retrouvées, de la langue.
III. L’ENVELOPPEMENT AL’ INFINI
Lorsque Duret, de Brosses, ou Court de Gébelin cherchaient à restituer l’état primitif des langues, ils reconstituaient un ensemble limité de sons, de mots, de contenus sémantiques et de règles de syntaxe. Pour former la racine commune de toutes les langues du monde, et pour se retrouver encore aujourd’hui en chacune d’elles, il fallait bien que cet idiome fût pauvre en éléments et limité dans ses lois de construction. À la limite, c’est un seul cri (un seul cri se différenciant de tout autre bruit ou s’opposant à un autre son articulé) qui est au sommet de la pyramide. La langue primitive est traditionnellement conçue comme un code pauvre. Celle de Brisset est au contraire un discours illimité dont la description ne peut jamais être achevée. Et cela pour plusieurs raisons.
Son analyse ne ramène pas un terme contemporain à un élément premier qu’on pourrait retrouver ailleurs et plus ou moins déguisé:
|PAGE 16
elle fait exploser successivement le mot en plusieurs combinaisons élémentaires, si bien que sa forme actuelle découvre, lorsqu’on la décompose, plusieurs états archaïques; ceux-ci, à l’origine, différaient les uns des autres, mais, par des jeux de tassements, de contractions, de modifications phonétiques propres à chacun, ils ont fini par converger tous vers une seule et même expression qui les regroupe et les contient. C’est à la science de Dieu de les faire réapparaître et de tourner comme un grand anneau multicolore autour du mot analysé. Ainsi pour l’expression «en société» : «En ce eau sieds-té = sieds-toi en cette eau. En seau sieds-té, en sauce y était; il était dans la sauce, en société. Le premier océan était un seau, une sauce, ou une mare, les ancêtres y étaient en société.» On est à l’opposé du procédé qui consiste à chercher une même racine pour plusieurs mots; il s’agit, pour une unité actuelle, de voir proliférer les états antérieurs qui sont venus cristalliser en elle. Replacée dans le vaste liquide primitif, toute expression actuelle révèle les facettes multiples qui l’ont formée, la limitent et desssinent pour le seul regard averti son invisible géométrie.
En outre, un même mot peut repasser plusieurs fois au filtre de l’analyse. Sa décomposition n’est pas univoque ni acquise une fois pour toutes. Il arrive bien souvent que Brisset la reprenne, et plusieurs fois, ainsi le verbe «être», analysé tantôt à partir d’ «avoir», tantôt à partir de «sexe». À la limite, on pourrait imaginer que chaque mot de la langue peut servir à analyser tous les autres; qu’ils sont tous, les uns pour les autres, principes de destruction; que la langue tout entière se décompose à partir d’elle-même; qu’elle est son propre filtre, et son propre état originaire; qu’elle est, dans sa forme actuelle, le résultat d’un jeu dont les éléments et les règles sont à peu de chose près empruntés à cette forme actuelle qui est celle justement que nous parlons. Si nous faisions passer n’importe quel mot d’aujourd’hui au filtre de tous les autres, il aurait autant d’origines qu’il y a d’autres mots dans la langue. Et, bien plus encore, si on se rappelle que chaque analyse donne, en groupe inséparable, plusieurs décompositions possibles, La recherche de son origine, selon Brisset, ne resserre pas la langue: elle la décompose et la multiplie par elle-même.
Enfin, dernier principe de prolifération: ce qu’on découvre, dans l’état premier de la langue, ce n’est pas un trésor, même fort riche, de mots; c’est une multiplicité d’énoncés. Sous un mot que nous prononçons, ce qui se cache, ce n’est pas un autre mot, ni même plusieurs mots soudés ensemble, c’est, la plupart du temps, une phrase ou une série de phrases. Voici la double étymologie -et
|PAGE 17
admirons justement la double gémellité -d’origine et d’imagination: «Eau rit, ore ist, oris. J’is noeud, gine. Oris = gine = la gine urine, l’eau rit gine. Au rige ist noeud. Origine. L’écoulement de l’eau est à l’origine de la parole. L’inversion de oris est rio, et rio ou rit eau, c’est le ruisseau. Quant au mot gine, il s’applique bientôt à la femelle: tu te limes à gine? Tu te l’imagines. Je me lime, à gine est? Je me l’imaginais, On ce, l’image ist né; on ce, lime a gine ai, on se l’imaginait. Lime a gine à sillon; l’image ist, noeud à sillon; l’image ist, n’ai à sillon.» L’état premier de la langue, ce n’était donc pas un ensemble définissable de symboles et de règles de construction; c’était une masse indéfinie d’énoncés, un ruissellement de choses dites: derrière les mots de notre dictionnaire, ce que nous devons retrouver ce ne sont point des constantes morphologiques, mais des affirmations, des questions, des souhaits, des commandements. Les mots, ce sont des fragments de discours tracés par eux-mêmes, des modalités d’énoncés figées et réduites au neutre. Avant les mots, il y avait les phrases; avant le vocabulaire, il y avait les énoncés; avant les syllabes et l’arrangement élémentaire des sons, il y avait l’indéfini murmure de tout ce qui se disait. Bien avant la langue, on parlait. Mais de quoi parlait-on? Sinon de cet homme qui n’existait pas encore puisqu’il n’était doté d’aucune langue; sinon de sa formation, de son lent arrachement à l’animalité; sinon du marécage auquel échappait avec peine son existence de têtard? De sorte que sous les mots de notre langue actuelle se font entendre des phrases -prononcées dans ces mêmes mots ou presque -par des hommes qui n’existaient pas encore et qui parlaient de leur naissance future. Il s’agit, dit Brisset, de «démontrer la création de l’homme avec des matériaux que nous allons prendre dans ta bouche, lecteur, où Dieu les avait placés avant que l’homme fût créé». Création double et entrecroisée de l’homme et des langues, sur fond d’un immense discours antérieur.
Chercher l’origine des langues pour Brisset, ce n’est pas leur trouver un principe de formation dans l’histoire, un jeu d’éléments révélables qui assurent leur construction, un réseau d’universelle communication entre elles. C’est plutôt ouvrir chacune sur une multiplicité sans limites; définir une unité stable dans une prolifération d’énoncés; retourner l’organisation du système vers l’extériorité des choses dites.
|PAGE 18
IV. LE BRUIT DES CHOSES DITES
«Voici les salauds pris; ils sont dans la sale eau pris, dans la salle aux prix. Les pris étaient les prisonniers que l’on devait égorger. En attendant le jour des pris, qui était aussi celui des prix, on les enfermait dans une salle, une eau sale, où on leur jetait des saloperies. Là on les insultait, on les appelait salauds. Le pris avait du prix. On le dévorait, et, pour tendre un piège, on offrait du pris et du prix: c’est du prix. C’est duperie, répondait le sage, n’accepte pas de prix, ô homme, c’est duperie.»
On le voit bien: il ne s’agit pas, pour Brisset, de réduire le plus possible la distance entre saloperie et duperie, pour rendre vraisemblable qu’on ait pu la franchir. D’un mot à l’autre, les épisodes fourmillent -des batailles, des victoires, des cages et des persécutions, des boucheries, des quartiers de chair humaine vendus et dévorés, des sages sceptiques, accroupis et boudeurs. L’élément commun aux deux mots -«pri» -n’assure pas le glissement de l’un à l’autre, puisqu’il est lui-même dissocié, relancé plusieurs fois, investi de rôles et chargé de sons différents: flexion du verbe prendre, abréviation de prisonnier, somme de monnaie, valeur d’une chose, récompense aussi (qu’on donne le jour du prix). Brisset ne rapproche pas les deux mots saloperie-duperie: il les éloigne l’un de l’autre, ou plutôt hérisse l’espace qui les sépare d’événements divers, de figures improbables et hétérogènes; il le peuple du plus grand nombre de différences possible. Mais il ne s’agit pas non plus de montrer comment s’est formé le mot saloperie ou le mot duperie. Le premier, par exemple, est déjà presque tout donné d’entrée de jeu: «Voilà les salauds pris»; il suffirait d’une désinence pour qu’il soit formé et qu’il se mette à exister. Mais il se décompose au contraire, disparaît presque -sale eau, salle -pour resurgir soudain tout formé et chargé du sens que nous lui donnons aujourd’hui: «On leur jetait des saloperies.» Non point lente genèse, acquisition progressive d’une forme et d’un contenu stables, mais apparition et disparition, clignotement du mot, éclipse et retour périodique, surgissement discontinu, fragmentation et recomposition.
En chacune de ses apparitions, le mot a une nouvelle forme, il a une signification différente, il désigne une réalité autre. Son unité n’est donc ni morphologique, ni sémantique, ni référentielle. Le mot n’existe que de faire corps avec une scène dans laquelle il surgit comme cri, murmure, commandement, récit; et son unité, il la doit d’une part au fait que, de scène en scène, malgré la diversité du décor, des acteurs et des péripéties, c’est le même bruit qui court, le même geste sonore qui se détache de la mêlée, et flotte un instant
|PAGE 19
au-dessus de l’épisode, comme son enseigne audible; d’autre part, au fait que ces scènes forment une histoire, et s’enchaînent de façon sensée selon les nécessités d’existence des grenouilles ancestrales. Un mot, c’est le paradoxe, le miracle, le merveilleux hasard d’un même bruit que, pour des raisons différentes, des personnages différents, visant des choses différentes, font retentir tout au long d’une histoire. C’est la série improbable du dé qui, sept fois de suite, tombe sur la même face, Peu importe qui parle, et, quand il parle, pour quoi dire, et en employant quel vocabulaire: le même cliquetis, invraisemblablement, retentit.
«Voici les salauds pris»: cri de guerre sans doute de nos ancêtres nageurs, rugissement de la victoire. Aussitôt, la rumeur de la bataille se répand: les messagers tout autour d’eux racontent la défaite des ennemis et comment on s’est emparé d’eux -dans la sale eau; murmure des grenouilles autour du marécage, froissement des roseaux au soir de la bataille, coassante nouvelle. Retentit alors le mot d’ordre; on hâte les préparatifs, les cages s’ en trouvent et se referment, et, sur le passage des captifs, la foule crie: «Dans la salle aux pris, dans la salle aux pris.» Mais les affamés, les avides, les avares, tous les marchands de la têtarde cité pensent plutôt à la viande et au marché; autres désirs, autres mots, même brouhaha: «Salle aux prix.» Les vaincus sont enfermés dans la région la plus fangeuse du marécage; mais quel narrateur, quelle grenouille vigilante, quel vieux scribe de l’herbe et de l’eau, ou encore quel penseur d’aujourd’hui, assez avancé dans l’intemporelle science de Dieu, note rêveusement qu’il s’agit là d’une bien sale eau et qu’on jette aux captifs des saloperies? Cependant, aux grilles de la prison, la foule bave et crie: «Salauds!» Et voilà qu’au -dessus de ces invectives multiples, de ces scènes bariolées traversées de cris de guerre se met à tourner la grande forme ailée, majestueuse, acharnée et noire de la saloperie elle-même. Bruit unique. Saloperie des guerres, et des victoires dans la boue. Saloperie de la foule en fête injuriant les captifs. Saloperie des prisons. Saloperies des récompenses distribuées, saloperie des marchés où s’achète la viande des hommes, Ce qui fait l’essence du mot, sa forme et son sens, son corps et son âme, c’est partout ce même bruit, toujours ce même bruit.
Quand ils partent à la recherche de l’origine du langage, les rêveurs se demandent toujours à quel moment le premier phonème s’est enfin arraché au bruit, introduisant d’un coup et une fois pour toutes, au-delà des choses et des gestes, l’ordre pur du symbolique. Folie de Brisset qui raconte, au contraire, comment des discours pris
|PAGE 20
dans des scènes, dans des luttes, dans le jeu incessant des appétits et des violences, forment peu à peu ce grand bruit répétitif qui est le mot, en chair et en os. Le mot n’apparaît pas quand cesse le bruit; il vient à naître avec sa forme bien découpée, avec tous ses sens multiples, lorsque les discours se sont tassés, recroquevillés, écrasés les uns vers les autres, dans la découpe sculpturale du bruissement. Brisset a inventé la définition du mot par l’ homophonie scénique.
V. LA FUITE DES IDÉES
Comme R. Roussel, comme Wolfson, Brisset pratique systématiquement l’à-peu-près. Mais l’important est de saisir où et de quelle manière joue cet à-peu-près.
Roussel a utilisé successivement deux procédés. L’un consiste à prendre une phrase, ou un élément de phrase quelconque, puis à la répéter, identique, sauf un léger accroc qui établit entre les deux formulations une distance où l’histoire tout entière doit se précipiter. L’autre consiste à prendre, selon le hasard où il s’offre, un fragment de texte, puis, par une série de répétitions transformantes, à en extraire une série de motifs tout à fait différents, hétérogènes entre eux, et sans lien sémantique ni syntaxique: le jeu est alors de tracer une histoire qui passe par tous les mots ainsi obtenus comme par autant d’étapes obligées. Chez Roussel, comme chez Brisset, il y a antériorité d’un discours trouvé au hasard ou anonymement répété; chez l’un et chez l’autre, il y a série, dans l’interstice des quasi-identités, d’apparitions de scènes merveilleuses avec lesquelles les mots font corps. Mais Roussel fait surgir ses mains, ses rails en mou de veau, ses automates cadavériques dans l’espace, étrangement vide et si difficile à combler, qui est ouvert, au coeur d’une phrase arbitraire, par la blessure d’une distance presque imperceptible. La faille d’une différence phonologique (entre pet b, par exemple) ne donne pas lieu, pour lui, à une simple distinction de sens, mais à un abîme presque infranchissable qu’il faut tout un discours pour réduire; et quand, d’un bord de la différence, on s’embarque vers l’autre, nul n’est sûr, après tout, que l’histoire parviendra bien à cette rive si proche, si identique. Brisset lui, saute, en un instant plus bref que toute pensée, d’un mot à l’autre: salaud, sale eau, salle aux prix, salle aux pris(onniers), saloperie; et le moindre de ces bonds minus cules qui changent à peine le son fait surgir chaque fois tout le bariolage d’une scène nouvelle: une bataille, un marécage, des prisonniers égorgés, un marché d’anthropophages. Autour du son qui demeure aussi proche que possible de son axe d’identité, les scènes tournent comme à la périphérie d’une grande roue; et ainsi
|PAGE 21
appelées chacune à son tour par des cris presque identiques, qu’elles sont chargées de justifier et en quelque sorte de porter elles-mêmes, elles forment, d’une manière absolument équivoque, une histoire de mots (induite en chacun de ses épisodes par le léger, l’inaudible glissement d’un mot à l’autre) et l’histoire de ces mots (la suite des scènes, d’où ces bruits sont nés, se sont élevés, puis figés pour for mer des mots).
Pour Wolfson, l’à-peu-près est un moyen de retourner sa propre langue comme on retourne un doigt de gant; de passer de l’autre côté au moment où elle arrive sur vous, et où elle va vous envelopper, vous envahir, se faire ingurgiter de force, vous remplir le corps d’objets mauvais et bruyants, et retentir longtemps dans votre tête. C’est le moyen de se retrouver soudain à l’extérieur, et d’entendre enfin hors patrie (hors matrie, pourrait-on dire) un langage neutralisé. L’à-peu-près assure, selon le furtif point de contact sonore, l’affleurement sémantique, entre une langue maternelle qu’il faut à la fois ne pas parler et ne pas entendre (alors que de toutes parts elle vous assiège) et des langues étrangères enfin lisses, calmes et désarmées. Grâce à ces ponts légers jetés d’une langue à l’autre, et savamment calculés d’avance, la fuite peut être instantanée, et l’étudiant en langue psychotique, à peine assailli par le furieux idiome de sa mère, fait retraite à l’étranger et n’entend plus enfin que des mots apaisés. L’opération de Brisset est inverse: autour d’un mot quel conque de sa langue, aussi gris qu’on peut le trouver dans le dictionnaire, il convoque, à grands cris allitératifs, d’autres mots dont chacun traîne derrière lui les vieilles scènes immémoriales du désir, de la guerre, de la sauvagerie, de la dévastation -ou les petites criailleries des démons et des grenouilles, sautillant au bord des marécages. Il entreprend de restituer les mots aux bruits qui les ont fait naître, et de remettre en scène les gestes, les assauts, les violences dont ils forment comme le blason maintenant silencieux. Rendre le thesaurus linguae gallicae au vacarme primitif; retransformer les mots en théâtre; replacer les sons dans ces gorges coassantes; les mêler à nouveau à tous ces lambeaux de chair arrachés et dévorés; les ériger comme un rêve terrible, et contraindre une fois encore les hommes à l’agenouillement: «Tous les mots étaient dans la bouche, ils ont dû y être mis sous une forme sensible, avant de prendre une forme spirituelle. Nous savons que l’ancêtre ne pensait pas d’abord à offrir un manger, mais une chose à adorer, un saint objet, une pieuse relique qui était son sexe le tourmentant.»
Je ne sais si les psychiatres, dans les ver

This opera by t ysm is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non opere derivate 3.0 Unported License.
Based on a work at www.tysm.org.